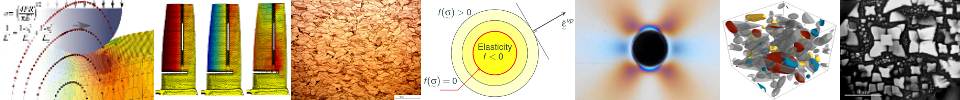

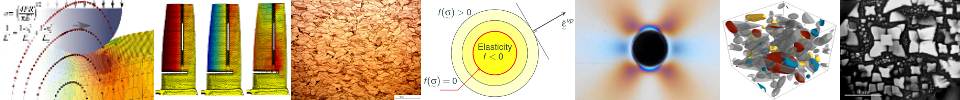

En tant que principal gestionnaire du réseau de transport de gaz en France (env. 33000 km), NaTran prend des mesures proactives en lançant des études visant à garantir l'intégrité de ses infrastructures dans un environnement contenant de l'hydrogène, dans un objectif d’utilisation de gaz plus respectueux de l’environnement. La fragilisation due à l'hydrogène est un phénomène bien identifié, mais qui continue de susciter de nombreuses interrogations quant à ses mécanismes sous-jacents. Un des mécanismes qui attire notre attention concerne la compréhension et l’interprétation de l’interaction entre plasticité et diffusion d’hydrogène. La diffusion de l’hydrogène au sein d’un acier peut être caractériser, en partie, à l’aide d’une cellule de perméation, qui permet de remonter à un coefficient de diffusion effectif. Ce coefficient est dépendant de plusieurs paramètres, dont notamment le nombre de piège qui lui est lié à la plasticité, en partie au travers des dislocations.
Entreprise partenaire : Natran R&I
Encadrants : Emilie HENRIQUES (GRTGaz Rice – INCA), Alexandre PERROT (GRTGaz Rice – INCA), Vincent FARRUGIA (GRTGaz Rice – INCA), Yazid MADI (CDM – Mines Paris), Jacques BESSON (CDM – Mines Paris)
Référence : 01-DMS-2025-NATRAN
Chez NATRAN, acteur clé du transport de gaz en France, l’intégrité des canalisations métalliques est une priorité. Lors de leur installation ou de leur maintenance, ces infrastructures peuvent subir divers dommages, parmi lesquels les enfoncements représentent une problématique majeure.
Un enfoncement correspond à une déformation plastique permanente de la paroi circulaire d’une canalisation, généralement causée par un impact extérieur, tel qu’un engin de chantier ou une pierre comprimée contre le tube lors de sa pose. Les normes actuelles d’évaluation de ces défauts se basent principalement sur la mesure de la profondeur de l’indentation par rapport au diamètre initial de la canalisation. Bien que robustes, ces critères ne prennent pas en compte la géométrie exacte de la zone indentée, ce qui peut entraîner une approche trop conservatrice.
Dans un contexte où la maîtrise des risques et des coûts est essentielle pour garantir l’intégrité du réseau, NATRAN cherche à développer des outils d’évaluation plus précis des zones indentées. Un des défis majeurs réside dans le fait que, sur le terrain, il est impossible d’accéder à la pièce ayant causé l’indentation, ni de reconstituer le chemin de chargement ayant conduit à la déformation.
Afin de surmonter ces limitations, nous envisageons d’exploiter des modèles basés sur le statistical learning qui utiliserait en entrée un scan de la zone enfoncée.
Entreprise partenaire : Natran R&I
Encadrants : Arnaud COQ (NaTran R&I – INCA), Vincent FARRUGIA (NaTran R&I – INCA), Pierre Kerfriden (CDM – Mines Paris), Yazid MADI (CDM – Mines Paris), Jacques BESSON (CDM – Mines Paris)
Référence : 02-DMS-2025-NATRAN
Contexte
Les aciers martensitiques à très haute résistance mécanique (jusqu’à 1500 MPa) présentent une microstructure complexe de martensite en lattes et une précipitation durcissante nanométrique. Outre une excellente résistance à la déformation plastique, ils doivent également présenter une bonne ténacité qui garantisse la fiabilité des pièces de structure.
Le développement de ces alliages passe par une meilleure compréhension des liens entre microstructure (en particulier, état de précipitation), résistance à la déformation plastique (et à sa localisation) et résistance à la fissuration ductile. Pour ce faire, il faut pouvoir tester le matériau à différentes étapes de conception / élaboration, depuis l’échelle laboratoire jusqu’à la production industrielle. Il faut en particulier savoir tester de petites quantités de matière et transposer les résultats à l'échelle industrielle, qui utilise des échantillons de plus grandes dimensions. Le projet s’inscrit dans cette démarche avec une insistance particulière sur la ténacité.
Objectif et travail proposé
Le projet vise tout d’abord à comparer les microstructures et la résistance à la rupture ductile, pour une même nuance et pour des productions à l’échelle laboratoire, pilote et industrielle. Il a également pour objectif d’établir et de valider un protocole de caractérisation sur mini-éprouvettes, plus à même de fournir des résultats très en amont dans le développement des alliages, et d’en étudier les conditions de transposition à des géométries d’éprouvettes plus traditionnelles (« macroscopiques »).
Les essais sur éprouvettes macroscopiques seront réalisés par Aubert et Duval. L’étudiant(e) assistera à une partie de ces essais et en traitera les résultats. Les essais sur mini-éprouvettes et les caractérisations microstructurales (microscopie électronique à balayage, éventuellement en transmission), ainsi que l’expertise de toutes les éprouvettes d’essais mécaniques (fractographie, chemin de fissuration dans la microstructure, localisation de la déformation) seront effectués au Centre des Matériaux.
Il est également prévu que l’étudiant(e) séjourne quelques semaines chez le partenaire industriel afin de confronter les pratiques et d’y transmettre les compétences notamment en termes de fractographie.
Un volet modélisation, minoritaire mais significatif, est également envisagé, notamment pour enrichir l’interprétation des essais de ténacité.
Encadrement
Romain Bordas et Evelyne Guyot (Aubert et Duval – Les Ancizes)
Référence : 03-DMS-2025-AUBERT&DUVAL
Contexte
La résilience d’un acier est l’énergie absorbée lors de la rupture par choc d’un barreau entaillé, à une température donnée. L’essai de résilience est un essai standard, très pratique pour le suivi des pièces forgées depuis le contrôle qualité jusqu’à la tenue sous irradiation, et permet de surveiller la reproductibilité des procédés de fabrication. Toutefois, la résilience des pièces forgées peut être considérablement dispersée : il arrive, dans certaines configurations défavorables, que des valeurs basses de résilience soient obtenues. Ces points bas de résilience sont liés à de nombreux facteurs et semblent être corrélés à des fluctuations de la composition locale de l’alliage (ségrégations), héritées de la solidification, et à des paramètres du procédé de mise en forme à chaud et des traitements thermiques de fin de fabrication, en particulier après les opérations finales de soudage.
Référence : 04-DMS-2025-FRAMATOME
Une nouvelle classe de procédés de fabrication additive indirecte et sans fusion sont arrivés ces dernières années sur le marché. Elles offrent des perspectives d’industrialisation pour la fabrication d’une moyenne série de pièces dans de nombreux secteurs (automobile, luxe, médical, …).Aujourd’hui, l’interaction entre le liant et/ou le polymère et la poudre est peu étudiée aux étapes d’impression, réticulation et déliantage en dehors des développements internes réalisés par les fabricants de machines. Par ailleurs, la parfaite densification (100% de densité relative) et la bonne santé matière (absence de phases exogènes, respect de la taille de grains) restent des verrous technologiques qui sont en grande partie liés au déliantage.
Pour répondre à une telle problématique, il est alors proposé de caractériser différents liants commerciaux avant une analyse physicochimique de pièces à vert déliantées. Ensuite des essais de frittage seront réalisés.
Les objectifs de cette étude :
Au premier semestre, un état de l'art sera réalisé à travers une étude bibliographique dédiée par l’étudiant·e de mastère, qui devra entreprendre quelques essais afin de se familiariser avec les équipements d’observation, d’analyse chimique et de mesure physique utilisés durant le second semestre. L’importante campagne expérimentale sera menée au second semestre, et concernera des essais de DSC, ATD, ATG, de pycnométrie liquide ou à gaz, de granulométrie laser, d’EBSD, de dureté, de flexion 4 points, de déliantage et de frittage, de trois pesées, d’observations au MEB et d’analyse EDS.
Référence : 05-DMS-2025
Contexte et objectif du stage :
Les procédés DED (Direct Energy Deposition ou Dépôt d’Energie Dirigée) sont des technologies de Fabrication Additive permettant la construction de pièces métalliques, l’ajout de fonctions ou encore la réparation de composants usagés. Toutefois, la solidification rapide inhérente à ces procédés de fabrication induit généralement la formation d’une microstructure colonnaire, caractérisée par des grains allongés, orientés selon la direction de solidification. Cette microstructure engendre une anisotropie des propriétés mécaniques en particulier dans la direction de construction, limitant le potentiel de ces matériaux pour des applications structurales.
L’objectif de ce stage est d’identifier, de concevoir et d’optimiser des cycles de traitement thermique post-fabrication permettant de conférer une structure équiaxe à des composants en acier haute résistance déposé par DED afin d’homogénéiser et d’améliorer ses propriétés mécaniques. Les propriétés mécaniques de référence sont celles d’un matériau forgé à grains équiaxes de petite taille.
Déroulement du stage :
1- Etude bibliographique
2- Analyse des états bruts de fabrication et de référence
Une comparaison des compositions chimiques des éléments majeurs, mineurs et traces sera systématiquement faite entre les matériaux de départ et les différents états après mise en forme (états bruts de fabrication et état forgé de référence) et avant l’application de post-traitements thermiques des bruts de fabrication en DED.
3- Identification de cycles thermiques pertinents par simulation et expérimentation
4- Expérimentation et caractérisation du/des cycle(s) sélectionné(s)
5- Analyse et recommandations
- Comparaison des différents cycles proposés.
- Sélection d’un ou plusieurs cycles thermiques optimisés et adaptés aux contraintes industrielles.
Encadrant : Christophe COLIN
référence : 06-DMS-25
Contexte et enjeux :
Dans le cadre du développement de connexions premium intégrales en acier à haute résistance pour l’industrie pétrolière et gazière, Vallourec s’attachent à optimiser la tenue en fatigue de ces assemblages, usinés, déformés à froid, puis traités thermiquement. Les coefficients de sécurité étant relativement faibles, il est essentiel de garantir une rupture progressive et ductile, même après de fortes pré‑déformations et/ou des chargements alternés. Une étude antérieure a mis en évidence un phénomène de déconsolidation cyclique influençant l’amorçage des fissures en fatigue oligocyclique. Néanmoins, cet effet n’a pas encore été formellement intégré dans un outil de simulation numérique robuste.
Objectif scientifique et professionnel :
Proposer un modèle simplifié d’initiation de rupture, fondé sur des essais de traction (lisses et entaillées) et des essais de fatigue oligocyclique, capable de rendre compte à la fois :
La première phase consistera à exploiter l’identification existante d’un modèle à comportement isotrope pour simuler, dans Abaqus, des connexions réelles dont les performances ont déjà été mesurées expérimentalement. La seconde phase visera à enrichir ce modèle en y intégrant un effet cinématique, afin de mieux prédire l’évolution de la tenue en fatigue sous cycles répétés.
Le candidat réalisera :
Entreprise partenaire :
Vallourec ONE R&D
Encadrants :
Référence : 07-DMS-2025
Encadrement
Contexte
Dans un contexte de prototypage, l’utilisation de mini-éprouvettes est un levier intéressant pour identifier un maximum de propriétés mécaniques en utilisant une quantité limitée de matière. Déjà utilisées pour le suivi en service des structures avec application au transport de l’hydrogène, ces mini-éprouvettes présentent cependant l’inconvénient de ne pas nécessairement être représentatives des résultats d’essais standards. On cherche ici à évaluer les propriétés en fatigue – chargement dimensionnant pour les pièces des turboréacteurs – à partir d’éprouvettes miniaturisées.
L'extrapolation des résultats obtenus à l’échelle miniaturisée soulève plusieurs interrogations, en particulier vis-à-vis des effets d’échelle, du volume élémentaire représentatif (VER) et des écarts potentiels avec les données issues d’éprouvettes standards. Toutes ces questions seront au centre de l’étude décrite dans ce document.
Objectifs du stage
Déroulement du stage
Profil recherché
Référence :08-DMS-2025
